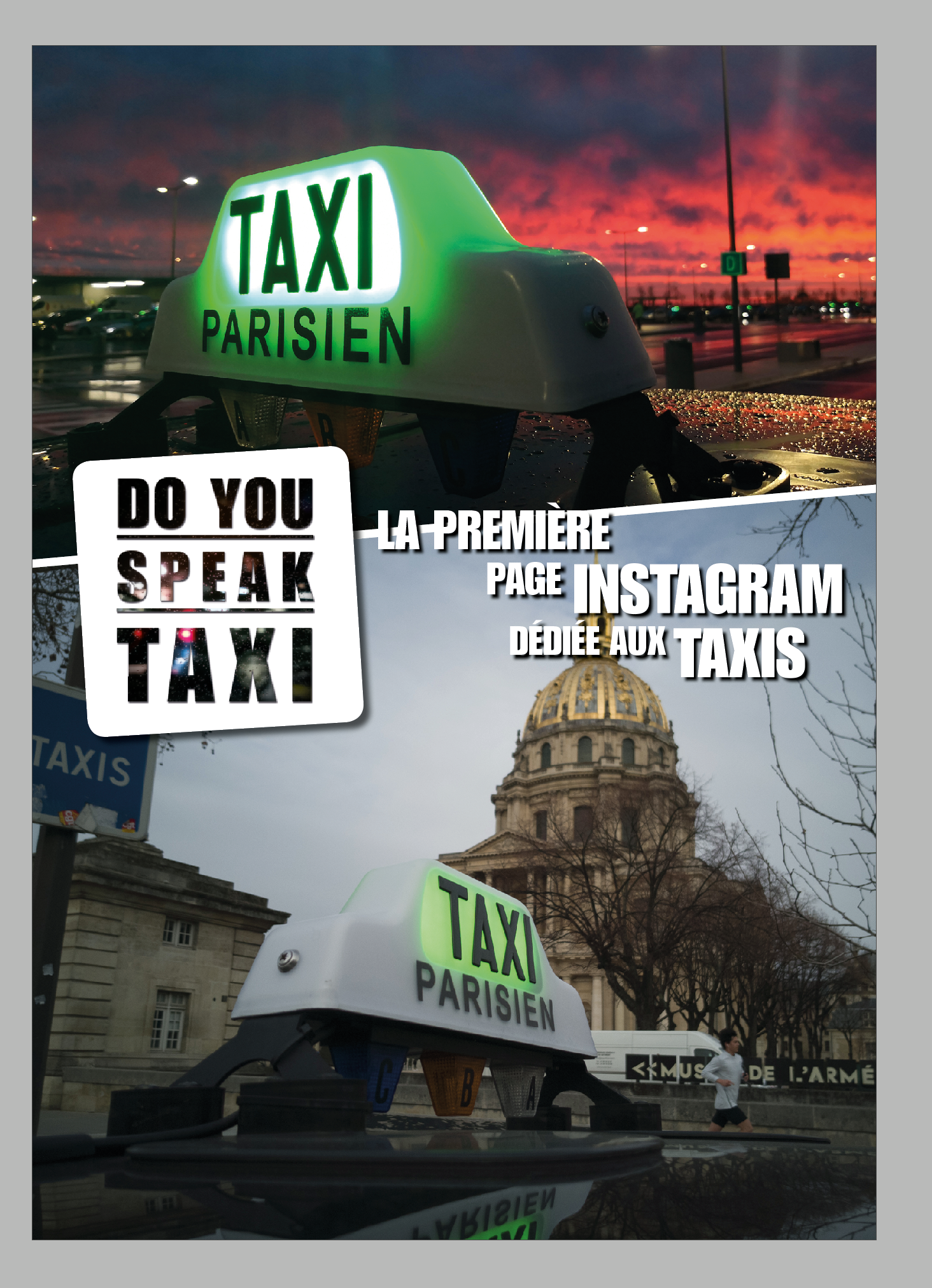Cette nouvelle défaite juridique d’Uber risque de faire boule de neige sur le développement du transport public particulier de personnes dans l’Union européenne. Dans son communiqué du 20 décembre, la Cour de justice de l’Union européenne a en effet mis face la multinationale à ses responsabilités. En France, les procédures initiées par les taxis et les conducteurs de VTC semblent marquer un tournant pour les pirates du numérique.
Viva España !
C’est grâce à une association professionnelle de taxi de Barcelone – Elite Taxi –, que le juge du Juzgado de lo Mercantil n° 3 – le tribunal de commerce de la ville – avait interrogé la CJUE sur son interprétation du cadre d’activité d’Uber. Saisi en 2014 par un recours des taxis contre la multinationale au motif de concurrence déloyale et pratiques commerciales trompeuses, le tribunal barcelonais avait usé de sa capacité de « renvoi préjudiciel » afin d’interroger l’Union européenne sur la qualification des services fournis par la plate-forme. Uber est-il un service de transport ou une plate-forme de services propres à la société de l’information ? En jeu, le choix entre l’application de la directive aux services dans le marché intérieur ou celle sur le commerce électronique laissant l’une comme l’autre une marge de manœuvre réglementaire totalement différente pour les États membres. Relevant « que l’application fournie par Uber est indispensable tant pour les chauffeurs que pour les personnes désireuses d’effectuer un déplacement urbain », la CJUE a également souligné « qu’Uber exerce aussi une influence décisive sur les conditions de la prestation des chauffeurs ». Considérant l’activité de la plate-forme comme service de transport, sans pour autant trancher le litige, la CJUE a confirmé l’autonomie des États pour réglementer le secteur.
 Dénomination trompeuse
Dénomination trompeuse
L’application numérique de transport Taxify, aujourd’hui dénommée « Txfy » a, quant à elle, été obligée, le 19 décembre dernier, par le tribunal de grande instance de Paris d’abandonner le terme « taxi » de sa dénomination française. Financée par le groupe chinois Didi, la start-up estonienne a été lancée en automne 2017 à grand renfort de soutiens médiatiques. Présentée comme le « Uber killer » et promettant « le VTC à prix cassé », l’application avait été assignée fin novembre 2017 par des syndicats de taxis français pour son utilisation illicite et trompeuse du terme « taxi ». « Cette confusion est volontaire puisqu’elle emprunte le terme litigieux à une profession concurrente. En conséquence, elle est susceptible de créer un préjudice à la profession de chauffeur de taxi, seule soumise à une réglementation contraignante », a défini l’ordonnance du jugement du TGI. Condamnée à verser une indemnité à plusieurs organisations de taxi, la plate-forme VTC s’est également vu imposer une astreinte immédiatement applicable de 1000 euros par jour de retard ou par infraction constatée. L’application a fait appel de la décision mais, tout en prétendant entamer un changement de nom, continue à être référencée sous ses deux patronymes dans sa communication.
Responsabilité sociale
L’initiative judiciaire n’est pas l’exclusivité des taxis car de nombreux chauffeurs de VTC ont entamé des procédures dont certaines commencent à porter leurs fruits. À la mi-décembre 2017, la plate-forme française de VTC Le Cab a été condamnée par la cour d’appel de Paris à requalifier un ancien chauffeur en salarié. Jugeant qu’ « il apparaît manifeste que dans la réalité de sa collaboration […] pareille organisation, dans le cadre contractuel venant d’être analysé, n’a aucune autre finalité que de créer de manière artificielle une apparence de collaboration entre une entreprise prestataire de service et un « travailleur indépendant », et en définitive de travestir la réalité en renvoyant au contraire à une relation de travail salarié », la cour d’appel confirme la décision validée en première instance par le conseil de prud’hommes de Paris malgré le pourvoi en cassation de la plate-forme. Enfin, le syndicat CFDT VTC-Loti a annoncé sa saisie du procureur de la République au tribunal de grande instance de Paris. Dénonçant la multiplication de plaintes abusives de clients ayant pour objectif de ne pas payer leur course transmise via les applications, l’organisation a déposé une plainte contre X afin de « mettre fin à [des] pratiques frauduleuses ayant pour unique objet le remboursement d’une course ».
HM

L’info du monde des taxis